Au Cameroun, écrire relève de l’acte de foi. Publier tient du pari. Être lu tient du miracle. Entre l’auteur précarisé, l’éditeur essoufflé et la critique quasi inexistante, la chaîne du livre ressemble davantage à un champ de ruines qu’à une industrie culturelle. Cette chronique ne plaide pas : elle autopsie. Elle est l’expression de mon appel à rompre — frontalement — avec le mensonge organisé d’un système, rouillé et à bout, qui maquille l’effacement littéraire en vitalité.
Au Cameroun, on écrit comme on respire : pour survivre. Mais publier y est un acte de perte. Diffuser, une utopie. Être lu relève de la légende. Le roman, la chronique, le poème, l’essai sociopolitique… tout ce qui sort d’une plume engagée ou non meurt sur les rives du silence. Étranglé par l’absence de politique, enterré sous la poussière de la non-circulation, suspendu dans un ciel sans lectorat.
L’expression « chaîne du livre » est ici une antiphrase. Il n’y a pas de chaîne, il n’y a pas de livre. Il y a des actes isolés, des publications au compte-gouttes, des éditeurs devenus comptables, des auteurs transformés en distributeurs ambulants, des lecteurs orphelins d’un système qui ne s’est jamais construit. Le tout servi par une classe dirigeante pour qui « littérature » rime avec « folklore », et par une élite molle, plus pressée de « paraître éditée » que de bâtir un monde lisible.
Rien n’est accidentel. Ce n’est pas une panne. C’est un programme. Une stratégie de déshérence intellectuelle, patiemment normalisée. Voilà pourquoi il ne s’agit plus de dénoncer un retard. Il s’agit de nommer une politique de sabotage.
Tout est en place pour que rien ne tienne
Il faut revenir aux faits bruts. Le nombre total de librairies spécialisées dans le livre généraliste au Cameroun est inférieur à 30, concentrées à 90 % entre Yaoundé et Douala. En dehors de ces centres, il n’existe aucun véritable circuit structuré de diffusion littéraire. Dans des villes comme Ebolowa, Garoua, Maroua, Bertoua ou Batouri un auteur camerounais contemporain, publié trois mois plutôt, est plus difficile à trouver qu’un « roman sud-africain traduit en norvégien ». Ce n’est pas une image : c’est un relevé de terrain.
Les auteurs, eux, survivent dans l’ombre. Sans rémunération. Sans système de sécurité sociale. Sans couverture contractuelle. Le cas de Guillaume Oyono Mbia de regrettée mémoire, avec qui nous avons travaillé dans le cadre de la réalisation d’un film documentaire, en est un exemple direct. Pour publier, il faut payer. Pour diffuser, supplier. Pour être chroniqué, prier. Certains vont jusqu’à offrir 10 exemplaires de leur propre livre à des journalistes ou influenceurs dans l’espoir d’un post Facebook. Ceux qui refusent de « participer aux frais » n’existent tout simplement pas.
Quant aux éditeurs, ils se battent pour survivre sur un sol administratif miné, qui réduit leur chance dans la production. Les droits de douanes ? Un autre chemin de croix. Pas de subventions durables. Pas de lignes budgétaires claires dans les politiques publiques. Pas de mécanismes d’achat institutionnel. Pas de commandes scolaires pour les œuvres camerounaises. Conséquence : le Cameroun perd plus de 500 milliards de F.CFA par an.
Dans les écoles, on enseigne Maupassant, Camus, Molière. Mais Mongo Beti, Sengat Kuo, Haman Mana, Bernard Nnanga, Patrice Nganang ou Philombé ne sont lus que sur recommandation nostalgique et/ou militante. Et pourtant, les ministères de la culture, de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire parlent de « valorisation de la production locale ». Jusqu’à quand allons-nous confondre « valoriser » et « ignorer avec élégance » ?
Effondrement n’est pas le mot. Il faut parler de sabotage.
Il ne s’agit pas seulement de défaillances techniques. Il s’agit d’un « schéma ». Une architecture d’inertie pensée pour que rien ne circule. L’État ne finance pas. L’élite n’investit pas. Les bibliothèques ferment ou se figent. L’université, quant à elle, a tourné le dos aux littératures vivantes.
Dans les départements de lettres modernes dans nos universités, les étudiants lisent Balzac, Ionesco, Zola. Très peu d’auteurs camerounais sont proposés à la lecture, et lorsqu’ils le sont, ce sont souvent ceux adoubés par les cercles littéraires parisiens du « Quartier latin ». On forme ainsi des lecteurs qui auront exploré toute la dramaturgie européenne avant d’avoir ouvert le moindre recueil de poésie de leur propre pays. Il y a dans cette architecture universitaire et scolaire un refus du présent — et un mépris glacial pour la production camerounaise contemporaine.
Et pourtant, nos auteurs existent. Publient. Pensent. Créent. Depuis plus de vingt ans, les Camerounais remportent des prix internationaux majeurs. Mais ces distinctions ne résonnent pas dans les murs de notre système éducatif : nos écoles, nos universités, nos bibliothèques. Rien. Elles ne provoquent ni révision des programmes, ni commandes publiques, ni plan de réimpression. Nos intellectuels vivent en exil — chez eux.
Que dire des critiques littéraires ? Rares. Sous-payés. Sans plateforme nationale pérenne. Aucun organe ne dispose d’un espace hebdomadaire garanti pour parler des livres camerounais. À quand remonte la dernière émission publique digne de ce nom consacrée à la sortie d’un recueil de nouvelles ? Le dernier débat sur l’essai d’un jeune chercheur du pays profond ? Il ne s’agit plus d’oubli. Il s’agit d’effacement. De sabotage !
Trois ruptures. Non négociables.
Il faut en finir avec les demi-mesures. Ce pays n’a pas besoin d’activités littéraires sponsorisées par une marque de téléphonie et snobée par l’Etat, nous faisons allusion, entre autres, à la semaine de la Littérature africaine au Cameroun qui se déroule depuis 2021. Il a besoin d’un choc structurel, loin des promesses politiques sans lendemain et des projets de loi voués à l’oubli avant même leur naissance.
- Créer un Fonds national d’appui à l’édition et à la circulation du livre camerounais, doté d’au moins 1 milliard FCFA par an. Pas une ligne symbolique dans un budget ministériel. Un fonds structurant, doté d’un comité d’experts, financé à hauteur du désastre. Il doit servir à financer les éditeurs sérieux, les imprimeries professionnelles, les diffuseurs engagés. Pas de copinage. Pas de clientélisme. Des appels à projets, des redevabilités vérifiables, et un système de suivi numérique des ventes et de la circulation effective.
- Rendre obligatoire la présence d’au moins 30 % d’œuvres camerounaises contemporaines dans tous les établissements publics de lecture : lycées, bibliothèques, universités. La politique d’achat publique ne doit plus renforcer la dépendance. Elle doit réparer. Commander local, lire local, penser depuis soi : c’est un acte de souveraineté. Ceux qui enseignent la littérature camerounaise doivent être formés. Ceux qui rédigent les programmes doivent cesser de penser que seule l’Europe et leurs copains méritent d’être lus sans accent.
- Réinscrire la lecture critique dans les programmes scolaires dès la classe de 4e, avec un accent particulier sur la littérature camerounaise contemporaine. On ne forme pas des lecteurs passifs. On forme des penseurs. Des citoyens capables d’interroger, d’interpréter, de critiquer. La lecture critique est une école de souveraineté intellectuelle. Elle doit être promue comme une matière essentielle. Pas comme un supplément d’âme.
Ce n’est pas une politique culturelle : c’est une extinction programmée
Nous n’avons plus le luxe de la tiédeur. Le luxe de l’attente. Le luxe des promesses floues. Nous avons dilapidé notre crédit symbolique, gaspillé les élans spontanés, usé jusqu’à la corde les bonnes volontés. L’heure n’est plus à « valoriser la lecture ». L’heure est à organiser, structurer, investir, bâtir. Sérieusement. Stratégiquement. Durablemement !
Il n’y a pas de filière du livre au Cameroun. Ce constat est brutal. Il doit cesser d’être nié. Il n’y a pas de système éditorial avec des maillons articulés. Pas d’écosystème viable qui relie écriture, édition, critique, distribution, lectorat, mémoire. Il y a des gestes de survie. Des envolées solitaires. Des éclats. Des talents orphelins. Des manuscrits errants.
Ce que nous appelons encore, avec une indulgence ironique, « chaîne du livre » est en réalité une corde raide. On la traverse seul, les yeux fermés, en espérant que le vent ne se lève pas. Aucune instance ne sécurise la démarche. Aucune structure ne relaie l’élan. Aucune politique ne soutient la traversée. C’est une aventure sans carte, sans boussole, sans filet.
Et pendant ce temps, nous continuons de perdre. Des voix. Des pages. Des mémoires. Des promesses. Nous perdons chaque jour la possibilité d’un avenir pensé depuis nos mots.
Alors il faut le dire une bonne fois : il est temps de construire. Une chaîne solide. Une politique du livre. Un marché. Une critique. Des prix crédibles. Une diffusion organisée. Il faut faire pour la littérature ce que nous prétendons vouloir pour l’économie : industrialiser, accompagner, connecter, distribuer, stimuler.
Sinon — et le risque est déjà là — nous continuerons de faire ce que nous faisons déjà si bien : Écrire. Publier. Disparaître. En silence. Avec dignité. Avec talent. Mais dans le vide !

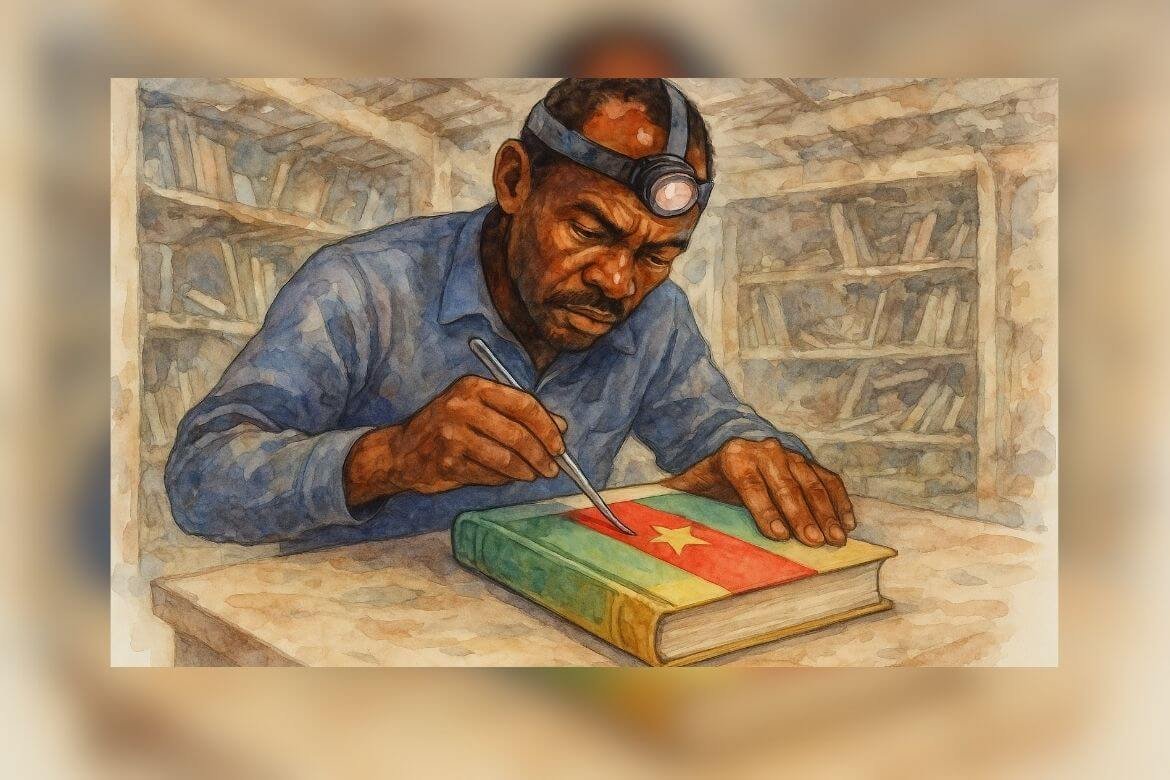
 L’Afrique au creux des lettres
L’Afrique au creux des lettres
3 Commentaires
Je découvre à travers ce texte, le chaos dans lequel se trouve l’industrie du livre si je puis l’appeler ainsi au Cameroun. Nos auteurs sont méconnus et ne sont pas valoriser dans notre système éducatif.
Ton article est un cri d’alarme qui j’espère ne sera pas noyé dans le néant de notre politique actuelle.
Merci d’avoir plongé dans cette plaie béante et profonde pour essayer d’extirper l’ultime raison de sa purulence. j’espère que ton « sacrifice » sera suffisamment choquant pour attirer l’attention de qui de droit .
Les Camerounais lisent.Ils ne font que cela.Il existe bel et bien une « génération tête baissée ». Que font ces têtes baissées? Elles lisent,pardi!Quoi? C’est le problème,dont la réponse serait le noyau autour duquel s’articuler ait l’ensemble des préoccupations soulevées ici.